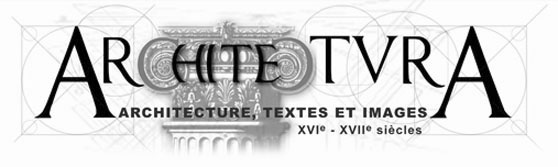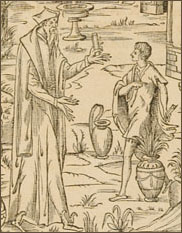| 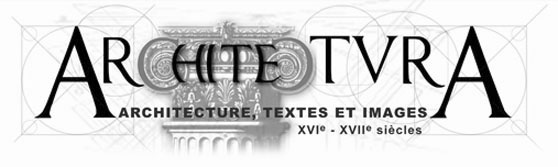
LES LIVRES D’ARCHITECTURE
Notice détaillée
| Auteur(s) |
Bullant, Jean |
| Titre |
Reigle generalle d’architecture... reveue et corrigee... |
| Adresse |
Paris, A. Sittart, 1619 |
| Localisation |
Rouen, Bibliothèque municipale, I 351 |
| Mots matière |
Antiquités, Ordres |
English
La page
de titre de l’édition de 1619 est très alléchante.
Elle annonce en effet que la Reigle de Jean Bullant (qui n’y est
pas nommé) a été « revue et corrigée » par Salomon de Brosse, l’architecte
du palais du Luxembourg. L’initiative de cette révision
serait due à un certain Nicolas Piloust, qui se présente
comme un ami du libraire Sittart. Ce dernier est le fils de Denise Cavellat, héritière de la fameuse dynastie qui avait compté parmi ses membres Guillaume Cavellat, associé à Jérôme de Marnef pour les premières éditions de Bullant ; Sittard a conservé du reste l’adresse et la marque familiales (au Mont Saint Hilaire, à l’enseigne du Pélican). Quant à Piloust, il est connu par ailleurs
pour avoir écrit un certain nombre d’ouvrages, sans rapport
avec l’architecture : La bienveillance royalle contre les
envieux (Paris, 1620), Le chant d’allégresse sur
le retour de la Royne, mère du Roy, en la faveur de la ville
et bourgeois de Paris (Paris, 1620), Le triomphe de la joye
sur l’heureux retour du Roy en sa ville de Paris (Paris,
1622) et un roman, Le chevalier enchanté (Paris, 1618).
En l’occurrence, sollicité par l’éditeur,
il aurait pris en main le travail d’édition, réécrit
le texte pour le rendre moins rugueux aux oreilles contemporaines, et
sollicité Salomon de Brosse pour la remise en ordre des illustrations.
Il est l’auteur de la dédicace, de l’adresse au lecteur,
et dédicataire d’un enthousiaste et anonyme sonnet acrostiche
qui vient se placer au folio A4, dans un riche cadre orné où
les instruments de l’architecte s’insèrent dans un
décor de cuirs.
On observe
de fait quelques modifications par rapport à l’édition
de 1568. L’ouvrage est désormais paginé ; les dédicace
et adresse au lecteur ont été remises à jour. Mais,
en dépit des annonces de Piloust, le texte demeure à l’exception
de détails infimes celui de 1568, dans une mise en page différente.
L’examen de cette édition s’avère donc décevant
par rapport à ce que le titre laissait espérer. En effet,
l’intervention de Salomon de Brosse est très limitée
: il n’y a aucune « augmentation ». Au contraire,
les planches de détail sur l’ordre corinthien ajoutées
par Bullant en 1568 aux folios G et G2 ont été supprimées,
ainsi que les textes qui les commentaient. De ce fait, le livre a deux
feuillets de moins que dans l’édition précédente.
Quant à la « revue », elle se limite à la
remise en ordre de certaines planches ajoutées en 1568, en particulier
celles des nouvelles représentations de l’ordre dorique
qui venaient s’intercaler entre des planches illustrant l’ionique
(ff. C4-D en 1568 ; en 1619, p. 17-19). Par ailleurs, l’éditeur
rectifie la légende qui au folio D3 de 1568 qualifiait de «
dorique » l’ordre du temple de la Fortune Virile, et ajoute
la précision « faute (sic) de pierre tiburtine
» (f. D3). Autre « correction » : alors que Bullant
représentait en 1568 au folio F2v° deux types de feuilles
pour orner la corbeille corinthienne, une feuille d’acanthe et
une feuille de laurier, la nouvelle version se limite à cette
dernière (p. 44), plus courante il est vrai sur les chapiteaux
réels, et se conforme curieusement à la première
édition de 1564 dans laquelle Bullant la présentait, sans
la nommer toutefois. Il apparaît en revanche quelques erreurs
de mise en page : la « porte ionique » de la page 37 et
la « volute composite » de la page 54 sont imprimées
à l’envers, le dorique de la page 11 est désigné
comme l’ordre « dioqure » (sic) du théâtre
de Marcellus, alors qu’il s’agit d’un modèle
théorique, et l’illustration du folio F qui devrait représenter
un ordre « corinthe selon la doctrine de Vitruve » se trouve
être la planche représentant l’ordre du temple des
Dioscures, qui du reste réapparaît à sa place légitime
à la page 47.
Quel fut
donc le rôle réel de Salomon de Brosse dans cette affaire
? Il n’était pas nécessaire de recourir à
un grand architecte pour procéder à la mise en ordre de
cette édition. Ce dernier s’est sans doute contenté
de prêter son nom afin d’assurer à la publication
d’un traité un peu ancien une légitimité
contemporaine, qui lui conférait un nouveau prestige au yeux
des clients : l’édition de 1619 est une opération
plus commerciale que « scientifique » au sens moderne du
terme. Elle connut néanmoins un certain succès : c’est
celle que cite Savot en 1624 dans la « bibliographie » de
son Architecture françoise des bastimens particuliers : «
Bullan (sic) des cinq ordres de colonnes, reveu par le Sieur de Brosse
Architecte du Roy » (p. 324). Et c’est aussi celle dont
usent ces Messieurs de l’Académie d’Architecture
lorsqu’ils entament le 5 mars 1672 la lecture du traité :
« Examinant les livres des ordres d’architecture de Jean
Bullant et les conférant avec ce qu’il fit bâtir
tant à Ecouen, à Chantilly qu’ailleurs, on a jugé
que c’était un architecte de grand mérite, qui a
suivi, par une méthode facile, la doctrine de Vitruve dans ses
écrits et fait voir dans ses ouvrages la beauté de son
génie. Ses écrits ont été en si grande estime
que M. de la Brosse, architecte du Roi, a bien voulu se donner la peine
de les commenter » (Procès verbaux de l’Académie
d’Architecture, Paris, éd. H. Lemonnier, 1911, I,
p. 12).
Yves Pauwels (Cesr, Tours) – 2006
Bibliographie critique
F.-C. James, Jean Bullant. Recherches sur l’architecture
française au XVIème siècle. Thèse de
l’École nationale des Chartes, 1968. Résumé
dans École nationale des Chartes, Positions de thèses,
1968, p. 101-109.
Y. Pauwels, « La fortune de la Reigle de Jean Bullant
», Journal de la Renaissance, 3, 2005, p. 111-119.
Notice
Reigle generalle d’architecture des cinq manieres de colonnes,
à scavoir, tuscane, dorique, ionique, corinthe & composite,
a l’exemple de l’antique suivant les reigles & doctrine
de Vitruve ; reveue et corrigée par monsieur de Brosse architecte
du roi. - Seconde et dernière édition. – A Paris
: en la boutique de Hierosme de Marnef. Chez André Sittart, au
Mont Sainct Hilaire, à l’enseigne du Pélican, 1619.
– [1]f.-56 p.-[1] f. (sig. A1 B-G4 H1) : illustrations gravées
sur bois. Folio.
Rouen, Bibliothèque municipale, I 351.
*Note(s) :
- Reliure en parchemin. Marque de Jérôme de Marnef au titre
(devise : « In me mors in me vita »).
Ex-libris : «
Ex. Bibliotheca PP. Capucinorum Rotomagensium 1732 ».
- Confiscation révolutionnaire.
|