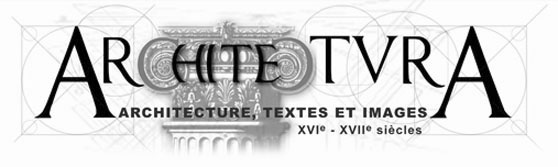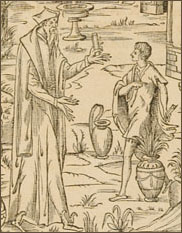| 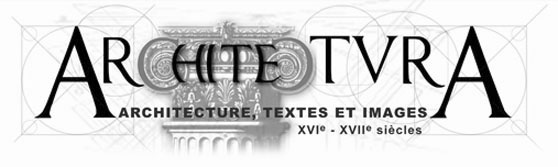
LES LIVRES D’ARCHITECTURE
Notice détaillée
| Auteur(s) |
Mollet, Claude I |
| Titre |
Theatre des plans et iardinages... |
| Adresse |
Paris, C. de Sercy, 1652 |
| Localisation |
Paris, Binha, 4° KO 807 |
| Mots matière |
Agriculture, Astrologie, Jardins |
English
À
la fin de l’année 1651, le roi accorde à Charles
de Sercy, imprimeur libraire depuis 1649, un privilège pour «
imprimer un manuscrit intitulé : Le Theatre des plans et
iardinages, composé par Claude Mollet, nostre premier jardinier
». Le volume porte un achevé d’imprimer du 22 janvier
1652 et ne mentionne pas le nom de l’auteur sur la page de garde.
Il comprend une dédicace signée par Charles de Sercy à
l’adresse de Nicolas Fouquet, faisant notamment allusion à
« ces superbes jardins de Vaux le Vicomte, où vous faites
agreablement combattre l’art avec la nature, et où vous
adjoustez tous les jours de nouvelles beautez et de nouveaux enrichissemens.
»
On connaît
aujourd’hui deux manuscrits de ce traité, dont les spécialistes
ont longtemps daté la rédaction aux alentours de 1615.
Le premier se trouve à la Staatsbibliothek de Munich (Cod. Gall.
496, in folio, 116 ff.). Le second manuscrit est conservé à
la Dumbarton Oaks Research Library and Collection de Washington, DC
(rare rbr O-2-5 Mollet, 42 cm, 188 ff.) depuis son acquisition à
Londres en 1956. Il s’ouvre par une dédicace à Louis
XIII, dans lequel l’auteur présente son ouvrage comme le
fruit de plus de cinquante années d’expérience au
service du roi et de son père, et déclare qu’il
a désormais soixante-dix-neuf ans. Claude I Mollet est probablement
né en 1557, puisqu’il est dit âgé de quatre-vingt-dix
ans lorsqu’il meurt à Paris le 23 mai 1647 (d’après
un document indiqué récemment par Emmanuel Lurin). Ce
manuscrit aurait donc reçu sa forme finale avant 1636. Une étude
récente d’Ada Segre (2006) signale que les textes des deux
manuscrits et de l’ouvrage imprimé sont essentiellement
les mêmes, pour la structure et le contenu (en dehors de la dédicace),
tandis que les illustrations sont toutes différentes. Le manuscrit
de Munich comporte trois dessins à l’encre montrant les
plans d’un labyrinthe octogonal (fol. 57), d’un parterre
de broderie (fol. 58-59) et d’un parterre barlong à «
carreaux rompus » et motif circulaire (fol. 60) ; des pages blanches
(fol. 61r°-68v°) y attendent douze illustrations de plans de jardins et
le texte des chapitres XXXII-XXXV indiqués dans le sommaire.
Sur la base du style archaïque de son écriture, l’historienne
propose de considérer ce manuscrit, belle copie presque finale
munie de corrections, comme le plus ancien. Rédigé d’une
main différente, le manuscrit de Dumbarton Oaks est postérieur
à celui de Munich ; on y rencontre la même absence des
chapitres annoncés, et on y trouve trente-deux gravures en format
folio. Enfin, deux indices permettent d’estimer la date de rédaction.
D’une part, comme nous le verrons plus loin, Claude I Mollet déclare
que quarante ou cinquante ans se sont écoulés depuis la
vogue, aujourd’hui démodée, des parterres illustrés
dans la Maison rustique (1583), ce qui indiquerait une fourchette
approximative entre 1623 et 1633. D’autre part, la mention de
l’année 1620 dans l’édition princeps
(p. 128) fournit un terminus post quem pour l’achèvement
du manuscrit qui fut imprimé par Charles de Sercy en 1652 ; le
texte de cette édition ne comporte pas les corrections de style,
les chapitres manquants ont été supprimés du sommaire
et la numérotation des chapitres suivants modifiée.
Cette publication
posthume du Théâtre des plans et jardinages succède
à celle, l’année précédente, du Jardin
de plaisir du plus célèbre des fils de Claude I Mollet,
André. Ce dernier y avait rendu hommage à son père,
célébré comme ayant « acquis par experience
et travail la qualité de premier jardinier de France »,
et y avait inséré son portrait gravé par Michel
Lasne, peut-être conçu initialement pour illustrer le Théâtre
des plans et jardinages. Les raisons précises pour lesquelles
le traité de Claude dut attendre vingt à trente ans après
sa rédaction pour paraître, à un moment où
André Mollet demeurait toujours en Suède, n’ont
pas été clairement élucidées.
L’organisation
de l’ouvrage, que l’on a pu juger « quelque peu confuse
» (Le Dantec 1996), se rattache à la tradition des
manuels généraux d’agronomie et économie
rurale, notamment représentée par Le théâtre
d’agriculture et mesnage des champs d’Olivier de Serres
(1600), dans lequel du reste des parterres réalisés par
Claude I Mollet avaient été publiés. La notion
même de « théâtre », qui réunit
les titres des deux traités, renvoie en réalité
à une ambition encyclopédique de somme des connaissances,
à la fois livresques et acquises par l’expérience
(« des secrets et des inventions »), que l’auteur
souhaite transmettre à ses collègues jardiniers –
comme le suggère la conclusion de l’ouvrage, en l’absence
d’avertissement au lecteur –, et non aux propriétaires
terriens auxquels s’adressait de Serres. Toujours à propos
du titre, il convient d’éclaircir une ambiguïté
lexicale que l’on n’a pas suffisamment relevée. Les
mots « plan » et « plant » ont souvent une graphie
identique dans la langue du début du XVIIe siècle ; ainsi
le Thresor de la langue française de Jean Nicot (1606)
définit-il « plant » comme « un dessein en
assiete sur rez de chaussée d'un bastiment qu'on veut eslever,
Ichnographia. Ainsi Plant aussi se prend pour le fondement
d'un bastiment soit de pierre soit de bois, comme le plant et assiete
du bauffroy est de telle largeur en tous sens. Plant aussi est une quantité
de jeunes arbres plantez à la ligne, Plantatio ».
Si Mollet utilise parfois la deuxième de ces trois acceptions
(c’est-à-dire la disposition spatiale au sol, par exemple
p. 199), il entend généralement « plan » dans
son sens végétal, tandis qu’il se réfère
aux représentations graphiques par les termes « pourtrait
» et « dessein ». Toute la première moitié
du livre touche effectivement à ce que nous appellerions l’horticulture,
le propos étant principalement distribué par espèces
et variétés. On aurait donc tort d’attendre du titre
un recueil de modèles gravés, du même genre par
exemple que Le thresor des parterres de l’univers de
Daniel Loris (1629), au texte en latin, français, allemand et
anglais : l’ouvrage de Claude I Mollet constitue pour l’essentiel
une encyclopédie de ce que l’on plante et des manières
de jardiner.
Olivier
de Serres avait soigneusement distribué son traité en
six parties et distingué, à l’intérieur de
celle consacrée aux jardins, quatre types : jardin potager, jardin
bouquetier, jardin médicinal et jardin fruitier ou verger. L’exposé
de Claude I Mollet est certes moins systématique mais présente
néanmoins une certaine cohérence dans la répartition
de ses cinquante-six chapitres en différentes séquences.
L’auteur
traite d’abord de la préparation du sol, évoquant
les différentes sortes de terre, le labour et les fumures (chapitres
1-3). Il passe alors longuement en revue les variétés
et les méthodes de culture des arbres fruitiers, à commencer
par les poiriers (4-14). Il aborde ensuite les « arbres agrestes
» ou « sauvages » (autrement dit présents dans
la forêt), tels que le chêne, le châtaignier et le
tilleul, qui servent à la plantation des allées et à
la réalisation de palissades, berceaux, bosquets ou cabinets
(15-16). Mollet explique comment multiplier ces essences fruitières
ou forestières en pépinière, comment les greffer
et comment planter des sujets de grande taille (17-19). Une section
est consacrée au jardin potager, dont Claude I Mollet –
comme le faisait Olivier de Serres – suggère la division
en une partie pour l’été et une autre pour l’hiver,
et distingue les productions en trois catégories : « racines
» ; « herbes » ou « feuilles » ; «
fruits » (20-23). La section suivante évoque les fleurs,
qu’il s’agisse d’arbres et arbustes à fleurs,
de fleurs hautes ou basses, ou encore de bulbeuses (24-28). Mollet
précise qu’il ne traite pas des plantes médicinales
(p. 186) : en réalité, cette partie du traité commence
à aborder ce qu’Olivier de Serres appelait « jardin
bouquetier ou à fleurs », et que Claude I Mollet qualifie
de « jardin de plaisir », terme qui donnera son titre au
livre de son fils André.
La section
suivante (29-33) expose comment concevoir l’ordre, autrement
dit le tracé, de ce « jardin de plaisir » : c’est
la partie qui a le plus retenu l’attention de l’historiographie,
car elle traite de composition spatiale et documente le développement
des parterres de broderie au début du XVIIe siècle. Il
est à noter que Mollet, selon un usage courant à la fin
du XVIe siècle et également présent chez de Serres,
appelle « compartiment » ce que nous définirions
comme parterre (surface ou ensemble de pièces découvertes
à motifs ornementaux), et emploie plus rarement le mot «
parterre » (par exemple p. 193 : « jardins tant parterres
que potagers »), dans un sens plus générique tel
que l’entendait la Maison rustique d’Estienne et
Liébault (« jardin à fleurs ») et que l’enregistre
le dictionnaire de Nicot (« la partie du jardin où n’y
a nuls arbres, et où sont les quarreaux de fleurs et d’herbes
entourez de bordures, Horti olitorium »). Ces chapitres
sont accompagnés de vingt-deux planches (insérées
entre les p. 202 et 203), signées par les fils de Claude I Mollet,
André, Jacques et Noël. Les douze premières représentent
des parterres de broderie (ces planches sont évoquées
p. 191 : « j’ay fait faire par mes enfans une douzaine de
compartimens de nouvelle invention en broderie, lesquels n’ont
point encore esté mis en lumière ») : huit modèles
de plan carré ornés d’une fontaine au centre, quatre
oblongs pour des parcelles plus réduites. Les dix autres planches
ne sont en revanche pas décrites dans le texte. Deux d’entre
elles figurent des parterres d’entrelacs (pl. 13-14), une formule
assez traditionnelle depuis les années 1580 au moins. La planche
16, due à André Mollet, illustre un parterre de pièces
coupées qui semble annoncer les « compartimens de gazon
» que celui-ci théorisera dans Le jardin de plaisir.
Les planches 17 et 18, signées par Claude – vraisemblablement
le fils de l’auteur, Claude II Mollet –, représentent
des bosquets avec des salles et cabinets de verdure. Les quatre dernières
montrent des labyrinthes ou « dédales » (pl. 19-22).
Il est à noter que la planche 15, figurant un seul quartier d’un
parterre de broderie de plan carré, ne porte pas de signature
mais peut être attribuée à André Mollet d’après
la gravure correspondante dans le manuscrit de Dumbarton Oaks. Toutes
ces figures, que Claude I Mollet appelle « desseins et pourtraits
», sont munies d’une échelle en toises afin de pouvoir
reporter le dessin sur le terrain. Le texte (p. 196) mentionne par ailleurs
sept autres planches illustrant des architectures de verdure (palissades,
berceaux, portiques, haies), absentes du livre imprimé comme
des manuscrits.
Dans le
passage le plus souvent cité de l’ouvrage, Mollet explique
que « le temps passé, il y a environ quarante ou cinquante
ans qu’il ne se faisoit que des petits compartiments dans chacun
quarré d’un jardin de diverses sortes de desseins, qui
se representent encores à present au livre de la Maison rustique
» (p. 199), allusion au traité de Charles Estienne traduit
et augmenté par Jean Liébault, connu par diverses éditions
à partir de 1564, dont celle de 1583 contient les premiers modèles
gravés de plans de jardin, illustrant en particulier des «
compartiments à carreaux rompus » (voir L’agriculture,
et maison rustique, Lyon, 1583, fol. 145r°-154v°).
Mollet poursuit en évoquant sa collaboration avec l’architecte
Étienne Dupérac, auquel il était intimement lié
(il fut le seul témoin de Claude I Mollet lors de son mariage
en 1597, et le parrain de sa fille Marie en 1600, selon les documents
retrouvés par Emmanuel Lurin), « apres son retour d’Italie,
qui fut en l’année mil cinq cens quatre vingts deux »
(p. 200 ; le retour de Dupérac date en réalité
de 1578), au service de Charles de Lorraine, duc d’Aumale, et
particulièrement à Anet – jardin où travaillait
déjà son père Jacques Mollet (p. 186) – ;
« iceluy sieur du Perac prit la peine luy-mesme de faire des desseins
et des pourtraicts de compartimens, pour me monstrer comme il falloit
faire de beaux jardins ; de telle maniere qu’un seul jardin n’estoit,
et ne faisoit qu’un seul compartiment my-party par grandes voyales
[allées]. […] Ce sont les premiers parterres et compartimens
en broderie qui ayent esté faits en France, c’est pourquoy
j’ay tousiours continué depuis de faire des grands volumes,
parce que l’experience monstre la verité ; de sorte que
je ne me suis plus arresté à faire des compartimens dans
des petits quarrez » (p. 200-201). L’auteur ajoute qu’il
fut amené pour la réalisation de ces parterres de broderie
à utiliser le buis – arbuste mal considéré
par ses prédécesseurs en raison de son odeur –,
employé en 1595 pour les parterres royaux à Saint-Germain-en-Laye
(illustrés par ailleurs dans l’ouvrage d’Olivier
de Serres), à Montceaux et dans le jardin de l’Étang
de Fontainebleau. Cette nouvelle catégorie des parterres de buis
en broderie s’était effectivement diffusée dans
les trois premières décennies du XVIIe siècle,
comme le confirment par ailleurs les marchés de plantation retrouvés
récemment par Aurélia Rostaing (2006), où apparaît
parfois l’expression parterre « en grand volume »,
locution employée par Mollet. Le vocabulaire formel des parterres
de broderie connaîtra une codification précise des ornements
principaux (rinceaux, fleurons, cartouches…), des éléments
décoratifs (chapelets, becs de corbin, dents de loup, feuilles
de refend, nilles simples ou doubles…) et des principes de composition
(naissances) dans les publications de Louis Liger (Le jardinier
fleuriste et historiographe, 1704, et Le nouveau théâtre
d’agriculture et mesnage des champs, 1713).
Le livre
se poursuit par la culture de la vigne (34-39). Les chapitres
40 à 51 constituent le « traicté d’astrologie
» annoncé dans le titre. Mollet y inclut des données
générales relevant de la météorologie au
sens classique – celui des Météores d’Aristote
–, évoquant les quatre éléments, les différentes
régions de l’atmosphère et les principaux phénomènes
météorologiques. Le chapitre 45 enseigne en particulier
certains signes qui permettent de prévoir le temps. Mollet explique
également comment jardiner en fonction des lunaisons, mais aussi
d’autres cycles astraux qui interviennent sur le climat, divulgue
les grandes lignées du système géocentrique et
détaille les différents vents. Ce souci de vulgariser
des savoirs relevant de ce que l’on appelait à la Renaissance
la « philosophie naturelle » ne doit pas étonner
: il se rencontre également au début du Théâtre
d’agriculture d’Olivier de Serres et, de manière
encore plus marquée, dans le premier des trois livres du Traité
du jardinage selon les raisons de la nature et de l’art de
Jacques Boyceau de la Barauderie (publication posthume en 1638).
Le propos
revient alors à des considérations plus concrètes.
Claude I Mollet explique comment mesurer (« toiser ») les
longueurs, surfaces et volumes de terre, puis comment établir
les niveaux et les alignements (52-53). La chapitre 54 porte sur
l’eau : l’auteur présente les différentes
doctrines sur l’origine des sources (« fontaines »)
– débat toujours ouvert depuis l’Antiquité
jusqu’à la consécration de l’origine pluviale
dans le De l’origine des fontaines (1674) de Pierre Perrault
–, expose comment trouver empiriquement des sources et s’attarde
sur la réalisation des canalisations et réseaux hydrauliques
; en revanche, il n’aborde pas les « embellissemens et artifices
qui se peuvent faire » (p. 338), domaine des fontainiers et non
des jardiniers, contrairement à Boyceau qui avait consacré
plusieurs chapitres à ces ornements (canaux, ruisseaux courants,
grottes…). L’ouvrage se termine par deux longs chapitres
sur des sujets caractéristiques de l’économie rustique
: l’élevage des vers à soie et celui des abeilles
(55-56). Claude I Mollet avait été aux côtés
d’Olivier de Serres l’un des artisans du développement
de la sériciculture sous Henri IV, plantant les premiers mûriers
blancs aux Tuileries ; en 1606, il participa au traité pour la
fondation d’une pépinière de 50 000 mûriers
blancs dans chaque diocèse et conclut avec d’autres de
ses associés un marché pour la plantation de mûriers
dans tout le royaume. Son texte fait d’ailleurs allusion aux expériences
fructueuses qu’il mène dans ce secteur la même année
(p. 340).
Le Théâtre
des plans et jardinages connaîtra chez le même imprimeur
trois rééditions en 1663, 1670 et 1678. Le début
du titre est alors simplifié en Théâtre des
jardinages tandis que le nom de l’auteur se trouve désormais
mentionné ; la dédicace à Fouquet est supprimée
en raison de la disgrâce du surintendant, de même que disparaît
la partie astrologique, sans doute considérée comme obsolète
à l’heure où l’héliocentrisme triomphe.
Hervé Brunon (Cnrs, Centre André
Chastel, Paris)
– 2007
Bibliographie critique
M. Conan, « Postface », A. Mollet, Le
Jardin de plaisir, Paris, Éditions du Moniteur, 1981, p.
99-115, republié sous le titre « Le Jardin de Plaisir d’André
Mollet », M. Conan, Essais de poétique des jardins,
Florence, Olschki, 2004, p. 135-168.
M. Conan, « Claude Mollet (v. 1563-v. 1649) et sa famille »,
M. Racine (éd.), Créateurs de jardins et de paysages de la Renaissance
au XXIe siècle. I. De la Renaissance au début du XIXe
siècle, Arles/Versailles,
Actes Sud/École nationale supérieure du paysage, 2001,
p. 23-31.
J.-P. Le Dantec, Jardins et paysages. Textes critiques de l’Antiquité
à nos jours, Paris, Larousse, 1996, p. 100-102.
S. Karling, « The Importance of André Mollet and His Family
for the Development of the French Formal Garden », E. B. MacDougall &
F. H. Hazlehurstin (éd.), The
French Formal Garden, Washington DC, Dumbarton Oaks, 1974, p. 3-25.
M. Laird, « Parterre, Grove and Flower Garden : European Horticulture
and Planting Design in John Evelyn’s Time », T. O’Malley & J. Wolschke-Bulmahnin (éd.), John
Evelyn’s « Elysium Britannicum » and European Gardening,
Washington
DC, Dumbarton Oaks, 1998, p. 171-219.
E. Lurin, « La belle vue de Saint-Germain-en-Laye. Nouveaux documents
sur les jardins en terrasses construits sous le règne d’Henri
IV », Bulletin de la Société des Historiens
de l’Art Français, 2003 (2004), p. 9-31.
A. Rostaing, « La bêche ou le compas ? Le métier
de jardinier dans la première moitié du XVIIe siècle
», G. Farhat (éd.), André Le Nôtre, fragments d’un paysage
culturel. Institutions, arts, sciences et techniques, Sceaux, Musée de l’Île-de-France, 2006,
p. 74-87.
A. V. Segre, « De la flore ornementale à l’ornement
horticole. Transferts de techniques et structures géométriques
», G. Farhat (éd.), André Le Nôtre, fragments d’un paysage
culturel. Institutions, arts, sciences et techniques, Sceaux, Musée de l’Île-de-France, 2006,
p. 188-203.
Notice
Theatre des plans et jardinages : contenant des secrets et des inventions
incognuës à tous ceux qui jusqu’à present se
sont meslez d’escrire sur cette matiere : Avec un traicté
d’astrologie, propre pour toutes sortes de personnes, et particulierement
pour ceux qui s’occupent à la culture des jardins. Le tout
enrichy de quantité de figures. A Paris, Chez Charles de Sercy,
au Palais, en la salle Dauphine, à la Bonne Foy Couronnée.
M.DC LII. Avec privilege du roy.
1 volume de [9] f. signés ã4-[1]-?4, 411 p., 22 planches
gravées sur cuivre, numérotées ; bandeaux et lettrines
gravés sur bois. 270 mm.
Les figures gravées sont signées Jacques, Claude, André
ou Noël Mollet. Dimensions moyennes des planches 205 x 200 mm.
Titre imprimé à l’encre rouge et noire. Devise et
marque d’imprimeur gravées au titre.
Privilège du roi (inséré à la suite du cahier
ã4) en date du 22 janvier 1652.
Dédicace à Nicolas Fouquet par Charles de Sercy (ãii-iii).
Première édition.
Livre posthume de Claude Mollet publié par son fils, André
Mollet. La page de titre est suivie d’une épître dédicatoire
au surintendant Nicolas Fouquet (voir M. Baridon, Les jardins : paysagistes,
jardiniers, poètes, Paris, Laffont, 1998, p. 683).
Paris, Bibliothèque de l’Inha, Collections Jacques Doucet,
4° KO 807.
*Notes :
- Belle reliure de l’époque en maroquin rouge, dos à
5 nerfs ornés de fleurons dorés et titre, encadrement
à la Du Seuil sur les plats.
- Acheté au libraire parisien Besombes en 1912, l’ouvrage
est enregistré à la Bibliothèque d’Art et d’Archéologie
Jacques Doucet le 12 décembre 1912.
|